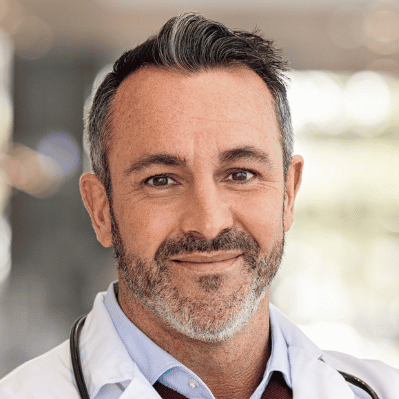Dix ans de données supplémentaires confirment le constat : malgré des progrès majeurs (capteurs en continu, pompes et boucles hybrides, optimisation des lipides et de la tension artérielle), l’espérance de vie d’une personne vivant avec un diabète de type 1 demeure inférieure à celle de la population générale. L’écart se réduit, mais il persiste, y compris chez des patients sans complication rénale. Le déterminant majeur reste l’exposition cumulée à l’hyperglycémie au long cours, à laquelle s’ajoutent tabagisme, dyslipidémie, hypertension, hypoglycémies sévères et variabilité glycémique.
Ce qui a changé depuis 2015
• Diffusion massive des CGM, pompes et boucles hybrides → meilleures nuits, moins d’hypoglycémies, time-in-range en hausse.
• Cibles lipidiques et tensionnelles plus strictes, statines élargies chez l’adulte à risque.
• Suivi centré sur HbA1c + time-in-range et réduction de la variabilité glycémique.
Espérance de vie : tendance 2015 → 2025
Les registres européens indiquent une amélioration nette de la survie par rapport aux cohortes historiques, mais un sur-risque de mortalité cardiovasculaire et globale demeure. L’absence de néphropathie (albuminurie/DFG altéré) réduit fortement ce risque, sans l’annuler : à HbA1c durablement élevée, l’exposition glycémique suffit à maintenir un excès d’événements cardiovasculaires après 50 ans, tandis qu’avant cet âge, les complications aiguës (acidocétoses, hypoglycémies sévères) pèsent davantage.
Chiffres-clés 2025 (ordres de grandeur)
• Excès de mortalité chez l’adulte DT1 sans complication rénale : encore ≈ ×1,5 à ×2 vs population générale, selon l’âge, la durée du diabète et le contrôle glycémique.
• Risque cardiovasculaire fortement lié à la dose d’hyperglycémie cumulée (HbA1c et variabilité).
• Écart d’espérance de vie en diminution vs années 1990–2000, mais toujours présent chez ceux avec contrôle glycémique sous-optimal.
L’effet dose de l’hyperglycémie
Plus l’HbA1c moyenne est élevée (et plus sa variabilité est importante), plus le risque de mortalité et d’événements cardiovasculaires croît. Les catégories HbA1c supérieure à ~8–9 % s’accompagnent d’un sur-risque marqué ; à l’inverse, un contrôle soutenu (autour de ≤7 % sans hypoglycémies sévères) rapproche les courbes de survie de celles de la population générale, surtout chez les sujets non fumeurs et bien pris en charge sur le plan tensionnel et lipidique.
Leçons durables : l’« effet mémoire »
Un contrôle glycémique intensif précoce chez le DT1 confère des bénéfices cardiovasculaires qui persistent des années plus tard, même si les HbA1c se rapprochent ensuite.
D’où l’intérêt d’optimiser la prise en charge dès le diagnostic et dans les premières années de maladie.
Le rein compte… mais ne suffit pas à expliquer le risque
La néphropathie diabétique demeure un prédicteur majeur d’événements et de mortalité. Cependant, l’absence d’atteinte rénale n’efface pas le poids des autres mécanismes : glycation avancée, dyslipidémie athérogène, inflammation de bas grade, atteinte autonome (variabilité de la fréquence cardiaque), apnée du sommeil, tabagisme, sédentarité et santé mentale. La prévention doit donc être multifactorielle, et pas seulement rénale.
Prise en charge 2025 : objectifs pratiques
- Glycémie : individualiser la cible d’HbA1c (souvent ≤7 %, plus souple si hypoglycémies). Viser ≥70 % de time-in-range 70–180 mg/dL avec CGM, limiter le temps <70 mg/dL.
- Technologies : privilégier CGM en continu, pompes et boucles hybrides quand éligible ; formation au comptage des glucides et à l’ajustement des doses.
- Lipides : LDL-c bas (cible stricte chez l’adulte à risque), diététique cardioprotectrice, statines selon âge/risque ; triglycérides surveillés.
- Tension artérielle : idéalement <130/80 mmHg avec mesures à domicile ; IEC/ARA2 si microalbuminurie.
- Mode de vie : non tabac, activité physique régulière, sommeil suffisant, prise en charge du stress et de la dépression.
- Sécurité : prévention des hypoglycémies sévères (éducation, glucagon prêt à l’emploi).
- Suivi rénal : albuminurie et DFG au moins annuel ; mais ne pas se limiter au rein pour estimer le risque cardiovasculaire.
Objectifs glycémiques (adulte DT1)
• HbA1c personnalisée, souvent autour de ≤7 %, plus haute si risque d’hypoglycémie.
• Time-in-range 70–180 mg/dL : ≥70 % ; time-below-range <70 mg/dL : <4 %.
• Réduction de la variabilité glycémique et des hypoglycémies nocturnes via CGM et automatisation de l’insuline.
Messages clés pour les patients et les soignants
- Sans complication rénale, le risque cardiovasculaire est moins élevé mais pas nul : il dépend surtout de l’historiques glycémique et des facteurs de risque associés.
- Le pilotage fin (CGM, boucles hybrides, optimisation lipides/T.A.) allonge l’espérance de vie et rapproche la trajectoire des courbes de la population générale.
- Les premières années de DT1 sont déterminantes : instaurer tôt un contrôle de qualité laisse une « empreinte » protectrice à long terme.
Sources 2025 (sans liens)
Registres nationaux européens du DT1 (pays nordiques/UK), analyses observationnelles 2015–2024 sur mortalité et événements CV.
Essais historiques et suivis prolongés (DCCT/EDIC) montrant l’« effet mémoire » du contrôle précoce.
Revues et recommandations récentes (sociétés savantes diabétologie/cardiologie) sur objectifs glycémiques, lipidiques et tensionnels dans le DT1.