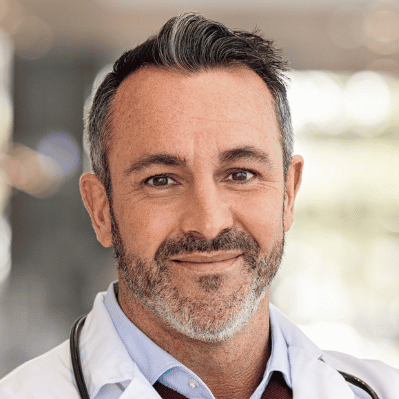Souvent cités comme des « alliés » santé, les acides gras oméga-3 existent sous plusieurs formes. Parmi eux, l’EPA (eicosapentaénoïque) et le DHA (docosahexaénoïque) — des oméga-3 à longue chaîne — s’intègrent aux membranes cellulaires et participent à de nombreux processus métaboliques. Quelles sources privilégier ? Quelles quantités viser ? Et que nous disent les études sur le cœur, le cerveau et la vision ?
Oméga-3 : rappels essentiels
Les acides gras polyinsaturés (AGPI) des familles n-3 (oméga-3) et n-6 sont dits essentiels : l’organisme en a besoin mais ne peut pas les synthétiser de novo. L’ALA (acide alpha-linolénique), oméga-3 d’origine végétale, constitue le socle de l’apport alimentaire (huiles de colza, lin, noix, soja…).
Synthèse endogène : de l’ALA vers l’EPA & le DHA
À partir de l’ALA, l’organisme peut produire des oméga-3 à longue chaîne (EPA puis DHA) grâce à des étapes d’élongation/désaturation. En pratique, la conversion est limitée et la formation de DHA est particulièrement faible (ordre de grandeur : < 1 %). D’où l’intérêt d’un apport alimentaire direct en EPA/DHA pour optimiser le statut tissulaire, chez l’enfant comme chez l’adulte.
En clair : associez un socle végétal riche en ALA (assaisonnement) et des sources marines régulières d’EPA/DHA (poissons gras, produits de la mer, certaines huiles de poisson).
Quelle dose viser ?
Les apports observés en France restent modestes. Repères couramment cités chez l’adulte : ≈ 250 mg/j de DHA et ≈ 500 mg/j pour EPA + DHA. Pour l’ALA, viser ~ 1 % de l’apport énergétique (≈ 1,8 g/j pour 2 000 kcal). Ce sont des balises alimentaires à combiner avec des habitudes variées et un bon équilibre n-6/n-3.
Prévention cardiovasculaire : où en est-on ?
Plusieurs études épidémiologiques et essais d’intervention associent la consommation de poisson ou d’EPA/DHA à une baisse de la mortalité cardiovasculaire, surtout en prévention secondaire. En prévention primaire, les résultats sont plus hétérogènes. Dans tous les cas, les oméga-3 s’inscrivent dans une approche globale : alimentation équilibrée et activité physique régulière demeurent la base.
Carences et réversibilité
Des déficits marqués en oméga-3 ont été associés à des troubles neurosensoriels (réversibles après réintroduction d’ALA/EPA/DHA). Chez le nourrisson, des apports insuffisants en AGPI n-3 peuvent appauvrir le DHA membranaire et retarder certains marqueurs du développement visuel ; une alimentation infantile équilibrée en oméga-3 corrige ces atteintes.
DHA : cerveau, vision et vieillissement
Le DHA est très abondant dans la rétine et le cerveau (constituant majeur des segments externes des photorécepteurs). Il contribue à la fluidité membranaire et à la signalisation. Chez l’adulte, plusieurs travaux suggèrent un intérêt des apports réguliers d’oméga-3 pour le vieillissement cérébral (humeur, fonctions cognitives) et la vision, avec des effets variables selon les populations et protocoles.
Où trouver les oméga-3 (EPA & DHA) ?
- Poissons gras : saumon, maquereau, hareng, sardine, anchois, thon — les plus riches en EPA/DHA (les teneurs varient selon l’espèce et la préparation).
- Produits de la mer : certaines conserves (sardine, anchois) et poissons fumés apportent des quantités intéressantes.
- Huiles de poisson : très concentrées en oméga-3 à longue chaîne.
- Végétaux (ALA) : huiles de colza, lin, noix, soja — utiles pour le socle n-3, mais conversion en DHA limitée.
Repère pratique : viser 2 portions de poisson par semaine, dont au moins une portion « grasse » riche en EPA/DHA, en variant espèces et origines pour la diversité nutritionnelle et la maîtrise de l’exposition aux contaminants.
Vision : ce que suggèrent les études
Chez l’animal, la carence alimentaire en oméga-3 diminue le DHA rétinien et altère la fonction visuelle. Chez l’humain, les données d’intervention sont nuancées, mais plusieurs cohortes pointent une réduction du risque de DMLA chez les consommateurs réguliers de poissons gras. Les mécanismes dépassent la simple teneur en DHA membranaire et pourraient impliquer des profils de réponse individuels (bons répondeurs).
Références
- Anses. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. 2011.
- ONIDOL, Tressou-Cosmao J, et al. Analyse des apports nutritionnels en acides gras de la population française à partir des données INCA 2. 2015.
- Anses. Apports en acides gras de la population vivant en France et comparaison aux ANC définis en 2010. 2015.
- Holman RT, et al. Am J Clin Nutr. 1982 ; 35 : 617-23.
- Guesnet P, Alessandri J. Cah Nutr Diét. 1995 ; 30 : 109-16.
- AREDS2 Research Group. JAMA. 2013 ; 309 : 2005-15.
- Souied EH, et al. Ophthalmology. 2013 ; 120 : 1619-31.
- Barberger-Gateau P, et al. J Alzheimer Dis. 2013 ; 33(Suppl 1) : S457-463.
Information à visée éducative — ne remplace pas un avis médical personnalisé.